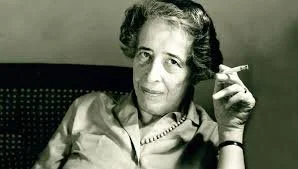Récits-stance #0
Pourquoi s’embarquer dans ce nouveau projet et, qui plus est, sous ce format ?
C’est ce que je tente de vous expliquer dans ce numéro #0 de mon infolettre.
Vue d’une utopie possible…
Cette dernière, je n’ai pas choisi de la lancer pour suivre une tendance ou pour soigner mon référencement.
Je l’écris parce que je sens que quelque chose est en train de nous asphyxier.
Parce que les récits dominants saturent l’espace, anesthésient l’imaginaire, étouffent la possibilité même d’une pensée vivante.
Et, parce qu’en tant qu’autrice, enseignante et citoyenne, je ressens aujourd’hui une forme de responsabilité.
Responsabilité envers les récits que l’on transmet. Envers ceux que l’on répète sans jamais les questionner. Envers ceux que l’on n’entend pas ou que l’on tait.
L’auteur du Petit Prince plus enjoué que mes étudiantes ! (source Wikipédia)
Tout est parti d’un exercice d’écriture créative donné à mes étudiantes à Sciences Po (1).
La consigne ?
Mettre en récit cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry :
“Chacun est responsable. Chacun est seul responsable. Chacun est responsable de tous.”
Fiction, conte, théâtre, discours, etc. : elles avaient carte blanche pour inventer, à partir de ces trois phrases, un cadre narratif.
Sur vingt-cinq copies, j’ai reçu vingt dystopies.
Pas par cynisme, ni par snobisme littéraire.
Mais parce qu’il semblait plus “pragmatique” et “réaliste” à mes étudiantes d’imaginer le pire…
Ce jour-là, j’ai ressenti un vertige. Pas parce qu’elles manquaient d’imagination. Mais parce que leur imaginaire semblait déjà pris.
Capturé par des récits de fin. Des récits d’ordre. Des récits de contrôle.
Colonisé par des histoires de catastrophe. De monde en ruine. De communauté en mille et un morceaux.
Ce jour-là, ce n’est pas la qualité de leurs copies qui m’a terrifiée.
C’est l’évidence narrative qu’elles révélaient : la dystopie était devenue leur, et donc notre, régime narratif par défaut.
Ce jour-là, l’idée de cette infolettre (2) a commencé à germer.
Non comme un projet de communication. Mais comme une enquête politique et littéraire.
Car ce qui vacille aujourd’hui, ce sont les récits.
Or, c’est par eux que tout commence et, parfois, que tout s’effondre.
Les sociétés humaines se construisent à partir de fictions partagées. Le récit, c’est ce qui nous donne une place, une direction, une mémoire. Il dit le monde et il dit aussi comment y agir. Il lie les êtres entre eux. Il permet ainsi de faire monde.
Alors que s’est-il passé ? Comment expliquer que nos imaginaires soient saturés ? Pourquoi cette sensation de lassitude généralisée face aux mots, aux images, aux discours qui circulent à toute vitesse mais ne portent plus rien ? Pourquoi cette impression que seul le pire peut désormais être raconté ?
Offre de Noël : -20 % à vie, déjà appliqués sur le prix affiché.
Sans doute parce que nous traversons ce que le philosophe coréen Byung-Chul Han appelle une “crise du récit” (3). Non pas du récit comme outil narratif, mais comme forme de liant symbolique.
Aujourd’hui, le récit est dissous dans un flot de contenus jetables, de fragments sans mémoire, d’émotions prémâchées.
Ce n’est pas que nous manquons d’histoires. C’est que nous n’avons plus d’espace pour en faire monde.
Là où le récit rassemblait autour d’un feu, le storytelling néolibéral de notre époque post-narrative s’adresse à des consommatrices isolées.
“Le feu de camp est éteint. Il est remplacé par l’écran digital.”
Sur les réseaux sociaux aussi, les stories n’en sont pas vraiment. Elles ne racontent rien. Elles s’accumulent, s’effacent. Elles nous dispersent au lieu de nous relier, nous divisent au lieu de nous rassembler.
Le récit, devenu vulgaire objet de consommation, ne crée plus de sens. Il remplit, sature, neutralise.
Han y voit une pathologie : un vide narratif comblé à la hâte, sans épaisseur ni mémoire.
Mais si Han trace la carte d’un effondrement, Hannah Arendt propose une boussole. (4)
Elle ne nie pas la perte. Elle aussi constate que :
“[à] chaque crise, c’est un pan du monde, quelque chose de commun à tous, qui s’écroule.”
Mais elle refuse d’y voir une fatalité.
Arendt ou comment fumer pour oublier que la banalité du mal existe… (source Wikipédia)
Une crise, écrit-elle
“ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c’est-à-dire des préjugés.”
En d’autres termes : ce n’est pas la crise qui est dangereuse. C’est notre manière d’y répondre.
La crise est un moment charnière.
Un moment où les anciens repères s’effondrent.
Un moment aussi où peut s’ouvrir un espace politique.
Un moment où l’on ne peut plus s’abriter derrière les routines du langage ni les récits préfabriqués.
Un moment où l’on est forcée d’écouter, de penser, de juger. Et, le tout, ensemble.
Ainsi, quand Han constate la désintégration du récit comme matrice de sens, Arendt, elle, nous enjoint de ne pas fuir ce vide. Elle nous rappelle qu’une autre manière d’habiter la crise du récit existe.
Encore faut-il ne pas céder à la tentation d’un retour nostalgique aux récits d’antan.
La crise, en effet, ne se surmonte pas à coup de restauration. Il s’agit, comme le disait Arendt, de revenir aux questions elles-mêmes.
D’inventer des formes, des gestes, des récits non pas pour retrouver un monde mais pour en réarticuler les possibles.
Cette infolettre est née précisément du refus d’abandonner ces possibles à celles et ceux qui défendent une conception industrielle du récit.
Elle s’appelle Récits-stance.
Parce que dans “stance”, il y a une manière de tenir – poétiquement et politiquement.
Parce qu’il faut bien choisir où l’on se place pour raconter.
Et parce que, même au cœur du désenchantement, je veux croire qu’il est encore possible de faire surgir autre chose.
Pas un nouveau grand récit.
Mais des formes alternatives. Des écritures bricolées. Des voix dissidentes. Des tentatives. Des lignes de fuite. Des narrations qui n’obéissent plus.
Chaque mois, j’explorerai une stance : une tension, une posture, une hypothèse d’écriture.
Avec ma voix. Avec celle d’invitées.
Pas pour prescrire ni pour faire cours. Mais pour chercher. Et transmettre des outils à celles et ceux qui, comme moi, pensent que le récit n’est pas en crise mais qu’il se loge ailleurs. Dans la marge. Dans les silences.
Prêtes pour partir avec moi à sa recherche ?
À tout bientôt,
Marianne
Offre de Noël : -20 % à vie, déjà appliqués sur le prix affiché.
(1) J’ai choisi d’opter pour le féminin générique dans l’écriture de cette infolettre. Ce choix formel pourra susciter un sentiment d’écart chez certains lecteurs. J’espère néanmoins qu’ils sauront s’y reconnaître ou, à défaut, s’y exposer. L’exercice de déplacement que cela suppose est aussi une manière de rééquilibrer les habitudes de lecture : pendant longtemps, ce sont les femmes qui ont dû faire ce pas de côté.
(2) Infolettre plutôt que newsletter parce que cela sonne pour moi comme une invitation à ralentir. Et parce que le travail sur les récits commence par leur matière première : les mots.
(3) Byung-Chul Han, La crise dans le récit, PUF, 2025, p. 25.
(4) Hannah Arendt, “La crise de l’éducation” In L’Humaine Condition, Gallimard, 2012, p. 747 ; p. 744.